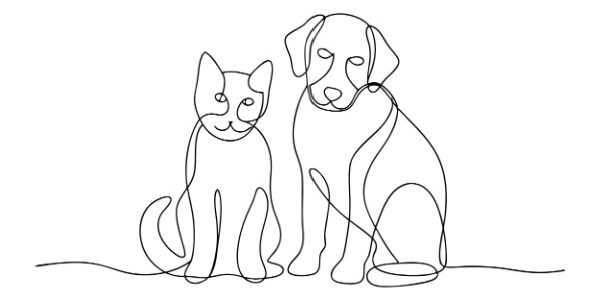La sécurité incendie est un critère fondamental dans le secteur immobilier et celui du BTP. À ce titre, les bâtiments doivent respecter un certain nombre de normes et, pour les établissements recevant du public, obtenir des autorisations d’ouverture, en vue de les rendre conformes. Des conditions qui viennent de faire l’objet de quelques aménagements…
Établissements recevant du public : un assouplissement pour certaines catégories
Pour ouvrir un établissement recevant du public (ERP), une autorisation délivrée par les pouvoirs publics est nécessaire dans l’objectif de s’assurer que l’établissement est conforme aux normes de sécurité applicables.
Une évolution est à noter à ce sujet, spécialement en ce qui concerne les normes applicables au titre de la lutte contre les incendies.
Ainsi, pour les établissements classés en 5e catégorie et qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public, la demande d’autorisation d’ouverture au titre de l’incendie ne sera plus exigée.
Il en va de même pour les autorisations de travaux au titre de la sécurité incendie pour un ERP classé en 5e catégorie et sans locaux d’hébergement pour le public. Seule une description succincte des travaux envisagés devra être communiquée pour informer les autorités compétentes.
Sécurité incendie pour les bâtiments : des exigences précisées
En matière de sécurité et de lutte contre les incendies, les bâtiments doivent, à toutes les étapes de leur « vie », respecter des normes précises.
Ainsi, tous les bâtiments doivent être implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l’objectif d’assurer la sécurité des personnes en contribuant à éviter les incendies. Ils doivent également intégrer des dispositifs permettant, en cas d’incendie, de limiter son développement, sa propagation, ses effets sur les personnes et de faciliter l’intervention des secours.
Des règles particulières s’appliquent alors en fonction des bâtiments (habitations, locaux professionnels ou établissements recevant du public).
Les exigences fonctionnelles à respecter pour assurer la sécurité des personnes sont précisées, de même que les modalités à respecter en cas de recours à « une solution d’effet équivalent ».
Ce type de solution permet au maître d’ouvrage de s’écarter d’une règle, dès lors qu’il démontre que la solution proposée assure un niveau de sécurité au moins équivalent, via des méthodes appropriées.
Ainsi, à partir du 1er juillet 2026, le maître d’ouvrage devra, pour recourir à une solution d’effet équivalent, procéder à une ou plusieurs études d’ingénierie de sécurité incendie.
Les exigences fonctionnelles, à respecter peu importe la solution adoptée, sont les suivantes :
- les solutions techniques doivent contribuer à éviter l’éclosion d’un incendie ;
- les produits, éléments de construction et matériaux d’aménagement doivent permettre de limiter le développement de l’incendie ;
- les solutions techniques doivent limiter la propagation de l’incendie, y compris vers ou depuis un autre bâtiment ;
- le bâtiment doit protéger les personnes :
- en étant stable à un incendie et adapté au plan d’évacuation ;
- en leur permettant de rejoindre rapidement et en sécurité l’extérieur ou de se réfugier dans un endroit les protégeant de l’incendie en attendant les secours ;
- en limitant leur exposition aux fumées et au gaz de combustion ;
- les solutions techniques doivent permettre l’intervention rapide, efficace et en sécurité des secours ;
- des équipements de sécurité sont présents, principalement un système de coupure de l’alimentation principale.
Notez que, parmi les informations devant être retranscrites dans le registre de sécurité incendie, doivent être précisées les études relatives aux solutions d’effet équivalent.
Sécurité incendie des bâtiments professionnels : du nouveau – © Copyright WebLex