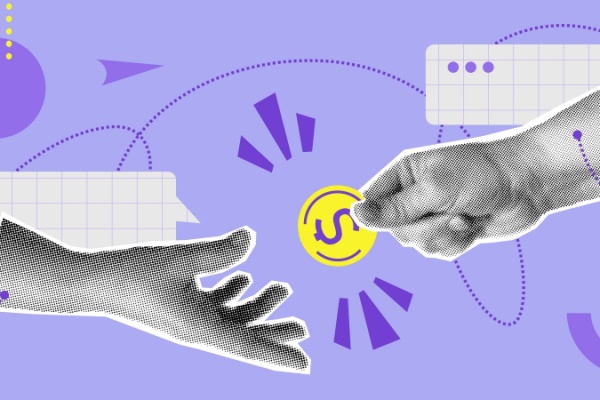Dans le cadre d’une procédure disciplinaire, un salarié convoqué à un entretien préalable risque des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement. L’employeur doit alors préciser la nature et le motif de la sanction envisagée. Mais une question cruciale s’est posée récemment : doit-il aussi informer le salarié de son droit à garder le silence ?
Entretien préalable : le « droit de se taire » réduit au silence ?
Lorsqu’un salarié est convoqué à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure disciplinaire, l’employeur doit indiquer la sanction envisagée et la raison sur laquelle elle se fonde…
En revanche et jusqu’à présent, rien n’imposait à l’employeur d’informer le salarié de son droit de garder le silence pendant cet entretien.
Pour certains salariés, cette absence d’information est contraire à la Constitution et plus précisément au principe fondamental selon lequel « nul n’est tenu de s’accuser », d’où découle le droit de se taire.
Dès lors, le fait de ne pas informer le salarié de son droit de se taire pendant l’entretien préalable violerait la Constitution.
Selon eux, une consécration d’un véritable « droit de se taire » est nécessaire, lequel se traduirait en droit du travail par une information préalable de l’employeur à cet égard.
Une position qui n’est pas partagée par le Conseil constitutionnel : en l’état, la réglementation est bel et bien conforme à la Constitution.
Dans sa décision, le Conseil rappelle que le droit de se taire, au sens constitutionnel du terme, ne s’applique qu’aux peines et sanctions ayant le caractère d’une punition. Ce qui n’est pas le cas des sanctions prises dans le cadre du droit du travail…
En effet, le « droit de se taire » consacré ici ne s’applique qu’aux punitions et sanctions traduisant l’exercice du pouvoir étatique (et de prérogatives de puissance publique).
Or, ici, les sanctions prises dans le cadre du droit du travail (et donc d’un contrat de travail privé) ne traduisent pas l’exercice d’une sanction au sens de l’autorité publique. Le droit de se taire tel que conçu par la Constitution ne trouve donc pas à s’appliquer donc ce cadre.
En définitive, les employeurs ne sont donc pas tenus d’informer le salarié de son droit de se taire, ni dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, ni même avant le début de l’entretien.
Entretien préalable : vous avez le droit de garder le silence… – © Copyright WebLex